

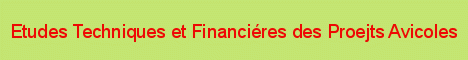
Définition
Infection virale respiratoire aiguë fortement contagieuse du poulet caractérisée par des râles, eternument en plus d’une atteinte rénale alors que chez les poules pondeuses, une chute de ponte et une détérioration de la qualité de l’œuf sont observés.
La mort peut survenir chez les jeunes comme une caractéristique des lésions respiratoires ou rénales.
Agent causal : Coronavirus.
*Un virus appartenant à la famille des Coronaviridae.
*Virus à ARN.
* Double brun.
*Symétrie hélicoïdale.
*Polarité négative.
*Sa réplication est intra cytoplasmique. |
*Virus modérément résistant dans le milieu extérieur et peut être détruit par les désinfectants ordinaires comme le permanganate de K et autres.
*N’est pas hémaglutinant sauf après son traitement par la phospholipase C.
*Plusieurs sérotypes ont été identifiés connecticut et Massachusette et autres, au sein de chaque sérotype ont été reconnues des variants. |
* Touche seulement le poulet.
* Tous les âges sont sensibles à la maladie mais les jeunes sont les plus sensibles.
* Distribution mondiale.
* La transmission de la maladie se fait par voie respiratoire ( inhalation )par voie orale ( élimination du virus dans les fientes durant 100 jours ).
* Suite à l’infection, le virus attaque la trachée ou il cause des signes plus ou moins sévères ( selon la souche ) puis il infecte les reins, le système reproducteur femelle ( selon le tropisme de la souche ).
* Le virus peut être re-isolé de la trachée, des poumons, des reins, de la bourse de Fabricius entre 1 à 7 jours post-infection au niveau des fèces pendant 20 semaines.
|
* Toux. * Eternument. * Râle. * Jetage oculo-nasal. |
* Fièvre.
* Abattement.
* Dépression.
* Rassemblement autour d’une source de chaleurs.
* L'agent infectieux ou s’il s’agit d’une souche à tropisme rénale.
* Si infection par des souches néphrogènes ( survenant surtout chez les oiseaux d’un âge entre 3 à 6 semaines ).
* Plumes ébouriffés.
* Diarrhée mucoide blanchâtre.
* Taux de mortalité élevé.
* Le taux de mortalité varie en fonction de l’âge, de la virulence de la souche et du statut immunitaire : 25 % pour les jeunes de moins de 6 semaines d’âge et moins élevée chez l’adulte. |
|
|
* Toux.
* Eternument.
* Râle.
* Rarement jetage oculo-nasal. |
* Abattement.
* Perte de poids.
* Diminution de la consommation de l’eau et de l’aliment. |
|
* Chute de ponte > 50% avec une baisse de la qualité externe et interne de l’œuf.
* Des œufs avec un albumen liquide qui a perdu sa consistance.
* Décoloration.
* Fragilité.
* Déformation de la coquille. |
|
| Le taux de morbidité est élevé alors que celui de la mortalité est faible. |
* Inflammation du système respiratoire.
* Exsudation catarrhale ou caséeuse au niveau de la trachée, les conduits naseaux et les sinus.
* Aérosacculite, sacs aériens opaque contenant de l’exsudat
* Si infection néphrogène : Hypertrophie et pâleur des reins avec dépôts d’urate au niveau des tubules rénaux surtout chez les jeunes oiseaux et poulet de chair => reins incapables de résorber le glucose, le sodium, le potassium => acidose => mort de l’oiseau.
* Follicules ovariens flasques, ponte intra-abdominale, parfois des ovaires hyoplasiés ou kystiques et vitellus dans la cavité abdominale.
* Salpingite, ovarite, péritonites.

* Oedème de la muqueuse trachéale.
* Hyperplasie cellulaire.
* Déciliation.
* Nodules lymphoïdes avec infiltration des hétérophiles.
* Néphrite interstitielle : dégénérescence granulaire.
* Desquamation de l’épithélium avec une infiltration par des hétérophiles.
* Nécrose des tubules rénaux.
Symptômes, lésions et historique de la maladie.
* Isolement et identification de l’agent causal.
* Prélèvement : Trachée, sac aériens, reins => inoculation chez des embryons de 9 à 10 jours dans le sac allantoïdiens => recherche d’un arrêt de croissance et des lésions néphrose.
* Technique de détection du virus par immunofluorescence des prélèvements de trachée : diagnostic rapide mais ne permet pas de différencier les sérotypes
Le meilleur moyen de diagnostic :
* ELISA ( outil idéal pour évaluer la réponse vaccinale et pour évaluer l’uniformité de transfert de l’immunité passive )
* IH ( moins coûteux, différencie les sérotypes chez les oiseaux lors de leur contact avec le virus et plus sensible que le test de neutralisation ).
* Neutralisation virale ( pour différencier les souches c’est le plus spécifique test).
Fiable et peut distinguer entre les différents sérotypes.
- NDV. - LTI. - Coryza infectieux. - EDS 76. - Mycoplasmoses. |
- Syndrome de la grosse tête. - Si forme rénale :
|
Respect des règles d’hygiène et application des normes de la biosécurité sanitaire sont les meilleurs moyens pour prévenir la maladie.
Tenant compte des études épidémiologiques pour le choix des vaccins du programme de vaccination, les différentes souches et leurs immunités.
- Par instillation oculaire.
- Voie intra-trachéale.
- Intra-nasale.
- Eau de boisson.
- Nébulisation.
NB : Il est préférable d’ajouter le lait écrémé en poudre dans l’eau de boisson pour stabiliser le virus vaccinal.
- Pas efficace mais on peut administrer des antibiotiques pour contrôler les complications secondaires et pour les souches néphrogènes, il est conseillé d’apporter du sodium et du potassium comme électrolytes pour renforcer la fonction rénale
- Chez les jeunes, améliorer les techniques d’élevage.
- L’augmentation de la température ambiante peut diminuer l’intensité de l’infection et accélérer la guérison.